|
|
|
![]()
BRUXELLES
UN PEU D'HISTOIRE
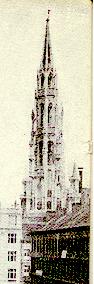
L’Hôtel de Ville comprend
actuellement une collection importante d’oeuvres d’art et tout particulièrement
de tapisseries bruxelloises. Mais il ne s’agit en fait
nullement d’un musée,
car le bâtiment abrite encore à l’heure actuelle une partie des services
communaux (les cabinets des échevins, le secrétariat communal, le
service du
protocole, ...). Toutes les salles au 1er étage, sont toujours utilisées
quotidiennement, que ce soit pour des réunions, des réceptions ou pour des
mariages.
Avant la fin du Moyen-Age,
l’autorité urbaine, constituée d’un nombre très limité de personnes, tenait ses
réunions en divers lieux. Mais la nécessité d’un bâtiment
conçu pour le
gouvernement local se fit sentir dès le XIVe siècle. Un Hôtel de Ville était la
marque en quelque sorte de l’autonomie et de la puissance
urbaines.
De dimensions modestes à l’origine, cet Hôtel de Ville devint dans le courant du XVe siècle un monument de plus en plus important.
Il se présente actuellement
comme un grand quadrilatère autour d’une cour centrale. La partie la plus
ancienne se trouve le long de la Grand-Place, elle est du XVe
siècle. Elle a
été réalisée en deux étapes: l’aile orientale en forme de L (le long de la rue
Charles Buls et de la Grand-Place jusqu’à la tour) est commencée en 1402
par
l’architecte J. Van Thienen. Quelques décennies plus tard, on décide d’agrandir
l’Hôtel de Ville et on construit l’aile occidentale jusqu’à la rue de la Tête
d’Or.
En 1449, une tour monumentale édifiée par J. Van Ruysbroek, vint
remplacer l’ancien beffroi. Elle mesure environ 96 m de haut, elle est surmontée
d’une statue de
St Michel, oeuvre de M. Van Rode (± 5 m de hauteur) posée en
1454 par la corporation des fondeurs sur un énorme roulement à bille. Cette
statue sert de
girouette. Elle a été enlevée pour restauration en
1993.
En 1695, Bruxelles est bombardé
durant 2 jours sur l’ordre du Maréchal de Villeroi, commandant les armées de
Louis XIV. Plus de 3000 maisons et bâtiments
publics disparaîtront dans la
tourmente. Si la structure de l’hôtel de Ville résiste, par contre tout
l’intérieur brûle; en quelques heures, les collections d’art et les
archives
disparaissent. Immédiatement après le bombardement, la Grand-Place sera
reconstruite et l’Hôtel de Ville restauré.
En 1712, Corneille Van Nerven
complète le quadrilatère en ajoutant deux ailes (le long de la rue de la Tête
d’Or et de la rue de l’Amigo). Cette nouvelle aile
abritera les réunions de
l’assemblée parlementaire locale, les États de Brabant.
Au XIXe siècle, on instaure un
grand programme de restauration de la tour, des façades et l’intérieur de la
partie gothique est renouvelé par Victor Jamar en 1868
dans l’esprit de son
maître à penser Viollet le Duc.
Dans le hall d’accueil une
allégorie de «l’équité, la fermeté et la bienveillance, vertus du gouvernement
municipal» par Xavier Mellery (1845-1921) peintre symboliste
bruxellois et
les bustes de LL.MM. le Roi Baudouin et la Reine Fabiola par le sculpteur H.
Lenaerts.
L’Escalier des Échevins est orné
d’un scène religieuse du Tintoret et d’une nature morte de
J.
Fyt.
La Galerie des souverains est
décorée de toute une série de portraits des souverains qui ont régné sur nos
régions jusqu’à la création du royaume de Belgique après
la révolution de
1830. Le Conseil Communal se réunit en général deux fois par mois dans la salle
du Conseil sur laquelle débouche la Galerie.
L’aile arrière avait été
construite à l’origine pour abriter les États de Brabant qui se composaient des
représentants de la noblesse, du clergé et de la bourgeoisie des
grandes
ville du Duché de Brabant. La décoration de la salle du Conseil Communal date du
XVIIIe siècle, à l’exception du mobilier qui est moderne:
- les emblèmes de la noblesse et
du clergé encadrent le miroir de la cheminée; en vis-à-vis,
se trouvent les
armoiries des trois principales ville du duché (Anvers, Bruxelles,
Louvain).
- le plafond peint par V.
Janssens représente l’Assemblée des Dieux, au centre de laquelle Jupiter tend la
couronne de Brabant à une figure représentant le Duché de
Brabant. Plus loin,
un autre allégorie porte la bannière avec les armes de
Brabant.
L’élément majeur de la
décoration est constitué par les trois tapisseries exécutées dans la manufacture
bruxelloise Leyniers et Reydams. On sait d’après les archives
qu’elles ont
été réalisées en 1717 (au moment de la construction de cette aile). Ces trois
tapisseries destinées à être encadrées n’ont jamais comporté de bordures.
Une
sorte de condensé de l’histoire du Duché de Brabant est présenté ici à travers
trois événements. Ils illustrent les trois dynasties qui ont gouverné entre le
XVe et
le XVIIIe siècle.
C’est par ailleurs dans la salle
Maximilienne que se réunit le Collège échevinal. Cette assemblée siège une fois
par semaine, elle est composée du bourgmestre, des
échevins et du secrétaire
communal.
Le nom de cette salle provient
du double portrait surmontant la cheminée représentant l’archiduc Maximilien
d’Autriche et son épouse la duchesse Marie de
Bourgogne. Leur mariage eut
lieu en 1477. Cette union marque le passage des princes belges dans les
possessions des Habsbourg. On peut voir par ailleurs un
portrait, par Alfred
Cluysenaar, datant du 19e siècle et une partie des tapisseries appartenant à la
suite de huit pièces racontant la vie de Clovis, roi des
Francs.
Les cartons des tapisseries sont
attribués à Charles Lebrun célèbre artiste français décédé en 1690. Elles ont
été réalisées à Bruxelles dans l’atelier de Jacques Van
der Borght, comme
l’attestait un monogramme disparu. Cette suite de tapisseries appartient à la
veine des grands sujets historiques dans lesquels excelle à l’époque
la
production bruxelloise. Celle-ci souffrira durement de la concurrence des
Gobelins au XVIIIe siècle.
La Galerie Grangé doit son nom à
l’artiste qui a réalisé toute la série de portraits des souverains espagnols en
1718. Elle donne sur l’antichambre du Bourgmestre où
se trouvent une série de
vues du vieux Bruxelles réalisées par Jean-Baptiste Van Moer (1819-1884) avant
les grands travaux de voûtement de la Senne et de
rénovation de la ville sous
le mandat du Bourgmestre Anspach.
Bruxelles commencera à se
développer à partir du Xe siècle. Lorsque Charles de France
(le frère du roi
Lothaire) est nommé duc de Basse Lotharingie par l’empereur Otton II, il érigea
un castrum sur une île de la Senne (l’île Saint-Géry). C’était un
endroit
stratégique intéressant, d’autant que c’est au niveau de cette île que la Senne
cessait d’être navigable. C’est donc tout naturellement au nord de cette île
que
se développera le premier port de Bruxelles. D’un bourg rural, Bruxelles
deviendra donc petit à petit une ville, et, cela en grande partie grâce à la
rivière. En 1561,
on inaugura le canal de Willebroeck dont les bassins seront
prolongés jusqu’au coeur de la vieille cité. Dans les siècles suivants, la
rivière servit surtout d’égout à ciel
ouvert dégageant des émanations
fétides. Lors de chaque averse, les eaux débordaient de leur lit, et toute la
ville basse se retrouvait inondée. Enfin, et cela ne se
perçoit pas sur les
peintures, les habitations tout autour étaient terriblement insalubres. Les
projets de rénovation de la ville seront donc confiés à
Léon Suys, et tous
ces quartiers vont disparaître en quelques années: les travaux ne dureront que 4
ans (de 1867 à 1871). La rivière sera donc voûtée et remplacée
par une série
de boulevards dans le même esprit que ceux du préfet Haussmans à Paris: des
artères larges, rectilignes, aérées.
Elle a toujours été utilisée
pour des réceptions, des manifestations officielles. A l’heure actuelle, on
l’emploie surtout pour les manifestations culturelles (concerts,
conférences,
colloques, ...). Tout le décor intérieur de la salle a été refait, en 1868, par
V. Jamaer en style néogothique. Les tapisseries sont les seules dans
les
collections de l’Hôtel de Ville qui ne proviennent pas de Bruxelles, la
Ville ne possédant plus de manufacture importante depuis 1794. Elles ont été
réalisées à
Malines dans les années 1875-1881.
Elles représentent les quatre serments militaires ainsi que des métiers de Bruxelles.
Les corporations bruxelloises
commenceront véritablement à jouer un rôle politique à partir de l’an 1421. A ce
moment-là, elles s’associeront en neuf nations, pour
participer au
gouvernement local, qui jusque-là était uniquement aux mains des patriciens.
Elles seront donc très importantes jusque sous l’occupation française qui
va
supprimer ce régime et confisquer les biens des corporations. Ainsi donc
jusqu’en 1794 ces corporations ont possédé leur maison à la
Grand-Place, ou
dans les environs et se réunissaient dans l’Hôtel de Ville.
Autrefois dans cette salle
siégeait le tribunal échevinal de Bruxelles. Depuis le XIXe siècle, elle sert de
cadre à la célébration des mariages civils de tous les habitants
domiciliés
sur le territoire de Bruxelles-Ville. La décoration (refaite au XIXe siècle)
nous rappelle aussi cette fonction:
- une peinture murale par Cardon (1881) représente la Ville présidant au mariage entourée par la Justice et la Loi.
- une broderie art nouveau
(modern style) par Isidor et Hélène De Rudder illustre l’Amour et la Loi
surmontés d’une ronde d’enfant symbolisant les espérances du
mariage. Au
centre, une fleur d’iris: considérée depuis le XIXe siècle comme un symbole de
Bruxelles. La légende prétend qu’à l’origine l’Île Saint Géry
était
entièrement recouverte de ces fleurs. Cette broderie a été réalisée en
1897; elle est un bel exemple du décor nouveau style qui eut un tel éclat à
Bruxelles
véritablement «la capitale de l’Art Nouveau». Cette broderie très
fragile a dû être protégée derrière une vitre. Néanmoins, il faut essayer de
l’imaginer dans son
emplacement orignal, derrière le siège de l’officier de
l’état civil, les deux allégories encadrant exactement ce siège. La présence des
corporations et les lignages est
une fois de plus rappelée ici, par les
différents blasons dans le plafond. Les statues représentent des personnalités
importantes de l’histoire de Bruxelles au XVe
–XVIe
siècle.
Enfin, l’Escalier d’honneur a
été construit au 19e siècle afin de rendre hommage au pouvoir communal. Il est
décoré d’une série de peintures du Comte J. de Lalaing
illustrant dans le
style académique différents thèmes relatifs à l’histoire de Bruxelles, ainsi que
par les bustes des bourgmestres qui ont gouverné notre cité
depuis
l’indépendance du pays en 1830.
RETOUR
![]()